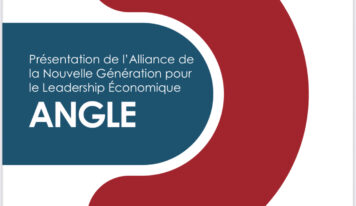L’histoire récente de la Guinée est marquée par un lourd passif d’impunité, où les crimes d’État et les violations des droits de l’homme restent souvent sans réponse judiciaire.
Le procès du massacre du 28 septembre 2009 portait l’espoir d’une rupture avec cette tradition, une occasion pour la justice guinéenne de démontrer son indépendance et son impartialité.
Pourtant, à l’issue des débats, une question demeure , peut-on condamner sans preuve au nom de la lutte contre l’impunité ?
Dès son ouverture, le procès du 28 septembre a été placé sous le signe d’une attente populaire forte.
Après plus d’une décennie d’attente, l’opinion publique, les familles des victimes et la communauté internationale exigeaient des réponses, et surtout des condamnations.
Mais la pression sociale et politique, couplée à l’inexpérience du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD), a pesé sur l’issue du procès.
Le capitaine Moussa Dadis Camara, ancien chef de la junte au pouvoir en 2009, est ainsi apparu comme le coupable désigné, le « bouc émissaire » d’un système qu’il n’était pourtant pas seul à incarner.
La justice guinéenne a-t-elle su démontrer sa responsabilité dans l’organisation du massacre ? À l’examen des faits, les éléments probants manquent.
Un principe fondamental du droit veut que, dans un procès pénal la culpabilité d’un accusé soit établie au-delà de tout doute raisonnable.
Or, tout au long du procès, le parquet s’est montré incapable d’apporter des preuves tangibles établissant un lien direct entre Dadis Camara et les événements du 28 septembre.
Aucune instruction formelle donnée aux forces de sécurité n’a été prouvée, aucun témoignage accablant ne s’est imposé avec certitude.
Si l’objectif était de sanctionner les véritables responsables, pourquoi d’autres figures clés du régime de transition de 2009 ont-elles été épargnées ? Des personnalités influentes comme Sékouba Konaté, alors ministre de la Défense, ainsi que plusieurs hauts responsables militaires et policiers, n’ont jamais été mises en accusation. Pourtant, leur rôle dans la chaîne de commandement interroge.
Ce procès aurait pu marquer une avancée historique pour la Guinée, en instaurant un précédent contre l’impunité. Mais en désignant un coupable idéal sans preuves irréfutables, il jette un doute sur la crédibilité du système judiciaire.
Si l’État guinéen veut réellement tourner la page, il lui faudra garantir à l’avenir des procès fondés sur des enquêtes approfondies, exemptes de toute instrumentalisation politique.
Face aux irrégularités manifestes de la procédure, la grâce accordée à Dadis Camara apparaît non pas comme un pardon, mais comme la reconnaissance implicite d’un verdict injuste.
Mais cette grâce, si elle lui rend sa liberté, ne lave pas son honneur. L’État guinéen a-t-il les moyens de réparer l’humiliation et le tort causé à un homme condamné sans preuve ?
Abdoul latif Diallo
Journaliste d’investigation
Très très indépendant